En 1137, l’abbé SUGER, d’origine paysanne, entreprend la rénovation de la Basilique Saint-Denis, dans un style architectural nouveau.
C’est la naissance du « Gothique ».
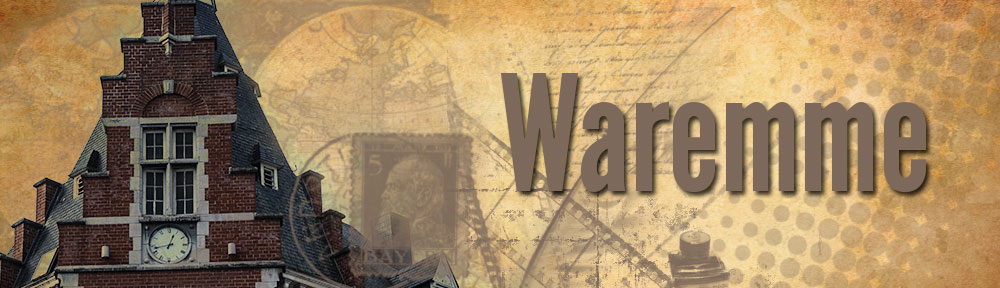
En 1137, l’abbé SUGER, d’origine paysanne, entreprend la rénovation de la Basilique Saint-Denis, dans un style architectural nouveau.
C’est la naissance du « Gothique ».
En 1130, la Seigneurie de Jeneffe de appartient à DE WARFUSEE Libert Sureal, Seigneur de Warfusée.
En 1141, l’advocatus de Hasbania, EUSTACHE, est le porte-étendard de l’armée liégeoise sur le champ de bataille de Bouillon. Porter l’étendard au combat est l’apanage d’un personnage important.
Les Croisades ont donné une vive impulsion à l’une des plus belles institutions du Moyen Age. La chevalerie, fruit de la religion et du sentiment de l’honneur, est une association de guerriers destinée à protéger les faibles contre les abus de la force. Les nobles seuls, après de longues épreuves, peuvent y entrer.
Dès l’âge de 7 ans, le futur chevalier est confié à quelque vaillant baron, qui lui donne l’exemple des vertus chevaleresques. Jusqu’à 14 ans, il accompagne le châtelain et la châtelaine comme page. Il les suit à la chasse, lance et rappelle le faucon, manie la lance et l’épée, s’endurcit aux plus rudes exercices. Par cette activité incessante, il se prépare aux fatigues de la guerre, et acquiert la force physique nécessaire pour porter les fortes armures du temps. A 15 ans, il devient écuyer. Il y a des écuyers de corps ou d’honneur, qui accompagnent à cheval le châtelain et la châtelaine ; des écuyers tranchants, qui servent à la table du seigneur ; des écuyers d’armes, qui portent sa lance et les diverses pièces de son armure. Les idées du temps ennoblissent ces services domestiques. Souvent, à 17 ans, l’écuyer part pour des expéditions lointaines. Enfin, lorsqu’il a 21 ans et qu’il parait digne par sa vaillance d’être fait chevalier, il se prépare à cette initiation par des cérémonies symboliques et religieuses. Le bain, signe de la pureté du corps et de l’âme, la veillée d’armes, la confession, la communion précédent la réception du nouveau chevalier. Couvert de vêtements de lin blanc, autre symbole de pureté morale, il est conduit à l’autel par deux chevaliers éprouvés, qui sont ses parrains d’armes. Un prêtre dit la messe et bénit l’épée. Le seigneur, qui doit armer le nouveau chevalier, le frappe de l’épée en lui disant : « Je te fais chevalier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Il lui fait jurer de consacrer ses armes à la défense des faibles et des opprimés, puis il lui donne l’accolade, et lui ceint l’épée. Les parrains d’arme couvrent le nouveau chevalier de diverses pièces de l’armure et lui chaussent les éperons dorés, signe distinctif de la dignité du chevalier.
La chevalerie confère des privilèges et impose des devoirs. Formés en association et liés par un serment d’honneur et de fraternité, les chevaliers se défendent mutuellement. Mais si l’un d’eux manque à la loyauté et à l’honneur, il est déclaré félon et dégradé solennellement.
Vers 1180 et à partir de la fin du 12ème siècle, les écoles monastiques disparaissent progressivement pour faire place à des écoles « capitulaires » (dépendant du chapitre) dans les villes. Ces écoles sont toujours fréquentées par les futurs clercs, mais aussi par des jeunes bourgeois et par des enfants de la campagne voisine. On y enseigne en langue vulgaire, plutôt qu’en latin.
A cette époque, renaissent les contacts entre civilisations différentes. Les Européens redécouvrent le raffinement oriental. Un enseignement supérieur est créé, des collèges et des universités voient le jour. Mais l’enseignement reste essentiellement confiné dans les villes. En effet, même si des écoles existent dans les campagnes, l’instruction qui y est donnée est essentiellement religieuse.
Vers 1100, les paysans (vilains, manants, roturiers), qui cultivent les terres du seigneur ou du Chapitre, résidant en ville, ne sont que demi-libres. Outre le loyer ou cens (d’où viendra plus tard le mot « censier ») et la dîme, ils payent la taille (impôt sur les revenus qu’ils vont plus tard continuer à payer au mayeur). En plus, ils payent des taxes, entre autres : sur le sel (impôt appelé gabelle dans certaines régions), qui restera jusqu’au début du XXe siècle l’élément indispensable pour conserver les viandes, de porc, notamment ; sur la mouture du blé : les paysans sont obligés d’aller faire moudre leurs grains dans un moulin à eau appartenant au seigneur ou au chapitre, les moulins à vent sont encore peu connus. (l’idée du moulin à vent sera rapportée d’Orient par les Croisés). Enfin, les paysans doivent au seigneur des corvées pour l’entretien du château, de ses dépendances et du village : murs, haies, bois, routes, fossés, « flots », … Les masuriers sont encore plus mal lotis.
Paysans et masuriers vivent misérablement. Les moyens de transport n’existent pas. La plupart des petites gens naissent et meurent sans avoir vu d’autre horizon que celui de leur village ou du village voisin.
Les routes sont en terre battue et se transforment en bourbier à la moindre averse. Elles suivent les pentes du terrain et aux endroits bas du village s’accumulent dans des mares appelées « flots ». Ces mares, couvertes d’une pellicule verdâtre, sont génératrices de miasmes de toutes sortes, lesquels alimentés par le manque d’hygiène élémentaire engendrent de fréquentes épidémies qui déciment la population. A côté des maladies de l’enfance qui entraînent la mort d’un grand nombre d’enfants, il y a le choléra (miserere), le typhus (dû aux poux), la fièvre typhoïde provoquée par les conditions d’hygiène désastreuses, le charbon (maladie particulière aux régions d’élevage), … La lèpre et la peste, ainsi que la famine, semblent être des cas isolé en Hesbaye. Cet état de chose va se prolonger jusqu’au début du XXe siècle à peu près, jusqu’à l’apparition de la médecine moderne.
Paysans et masuriers habitent des maisons en terre dans lesquelles on descend par quelques marches. La plupart ne comportent que deux pièces : l’une servant de cuisine, l’autre de chambre.
Il n’y a pas de meuble, sinon un coffre qui sert de garde-robe et de table. Les habitants dorment par terre, sur des paillasses, grands-parents, parents et enfants, dans une promiscuité génératrice de maladies et de turpitudes. Il n’y a pas de chaises, mais des escabeaux. Il n’y a pas de poêle de chauffage : ceux qui ont les moyens disposent d’une cheminée à feu ouvert ; les autres cuisent sur un four fait de quatre pierres assemblées. Dans les masures, l’éclairage est nul, en dehors de la chandelle de suif qu’on n’allume qu’en cas de nécessité urgente.
On mange du pain noir, qu’on va faire cuire au four banal (en payant bien sûr). Il s’agit du pain de seigle et d’épeautre. L’épeautre est la céréale la plus cultivée parce qu’elle se contente d’une terre maigre et peu travaillée (le froment qui est la céréale des terres riches, bien engraissées et bien ameublies, n’apparaît semble-t-il qu’au XVIIIe siècle). Les plus pauvres, sur leur lopin de terre, préfèrent le seigle parce que sa paille servait à plusieurs usages : toit de la cabane, paillasse, liens, …
Le pain non bluté est frotté d’un peu de saindoux ou de graisse de lard (récoltée en faisant fondre un morceau de lard dans la cheminée) ou de maquée.
Comme repas chaud, la soupe à base de légumes et de lard (la pomme de terre était inconnue à cette époque).
On boit de l’eau, du petit-lait (le bon lait étant réservé aux malades) et de la cervoise (espèce de mauvaise bière). L’abus de cervoise était générateur de bagarres fréquentes.
Les gens du peuple portent des vêtements de bure. La plupart sont chaussés de sandales en écorce et parfois de sabots.
La médecine et la pharmacie sont inexistantes. Certaines personnes qui ont hérité du secret des plantes, prescrivent des tisanes additionnées de miel et parfois de sucre. Le sucre, importé d’Orient après les Croisades, est un produit rare, utilisé uniquement en pharmacie.
La pratique religieuse est obligatoire, et sans doute nécessaire pour soutenir l’homme à travers ses misères. Les nantis lui serinent à longueur de journée que plus il est malheureux ici-bas, plus il sera heureux dans l’au-delà.
La vie des « petites gens » n’a aucune valeur pour leur maître, sinon au travers du travail qu’elles peuvent accomplir pour lui assurer son bien-être. Ainsi, en temps de guerre, seuls les nobles sont soignés. Les soldats blessés sont laissés livrés à eux-mêmes ; parfois ils sont envoyés mourir derrière une haie où un préposé à cette sinistre besogne les acheve. Mais dès que l’homme est mort, il redevient la propriété de Dieu et devient sacré.
La justice est aux mains du seigneur. Jusqu’au début du 14ème siècle, il a droit de vie et de mort sur tous ses sujets. C’est l’époque des « duels judiciaires » et des « jugements de Dieu ». En cas de délit grave, les plaignants doivent parfois se battre à mort ; le vainqueur est désigné comme l’innocent. Ou, pour faire preuve de son innocence, l’accusé doit prendre en main une barre de fer rougie au feu ou mettre en bouche une cuiller d’huile bouillante. Mais sous l’influence des Métiers de Liège et aussi de l’Eglise, qui s’emploie à réfréner les ardeurs belliqueuses et criminelles des seigneurs, des cours de justice locales vont se constituer.
Cette justice, bien que plus modérée en raison de la présence d’échevins-jurés, est encore barbare dans son déroulement et ses sanctions. On y applique encore la « question » (torture) et la loi du Talion, qui consiste à punir le coupable par l’injure qu’il a faite : si au cours d’une rixe, il a crevé un œil à son adversaire, on lui crève également un œil. La peine de prison (oubliettes) n’existe plus. Pour les petits délits on applique le fouet ou la bastonnade ; pour les délits les plus graves la mort par la corde, le feu ou d’autres procédés plus « raffinés ». Chaque condamné doit, en plus, payer une amende en rapport avec son forfait et faire un pèlerinage d’amendement, parfois très loin (Rocamadour en France, Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, Rome en Italie, ou en Terre Sainte). Celui qui ne s’y soumet pas est rejeté, non seulement de l’Eglise, mais aussi de la communauté : il est alors déclaré « aubain », c’est-à-dire banni.
L’instruction n’existe pas. En dehors de gens d’Eglise, la plupart sont illettrés.
Les loisirs sont inconnus : hommes, femmes et enfants travaillent comme des bêtes de l’aube au crépuscule, passant leurs dimanches aux offices et à se reposer.
Mais parfois, les sujets du seigneur sont autorisés à assister aux tournois ou à l’une ou l’autre représentation que viennent donner des baladins (chanteurs, comédiens, saltimbanques, montreurs d’ours, …) qui vont de château en château pour distraire les châtelaines en train d’attendre le seigneur, la plupart du temps absent.
Le chevalier LEXHY DE WAROUX DE JENEFFE Libert, né en 1163, est châtelain de Waremme en 1219.
Mais comment celui-ci est-il devenu châtelain de Waremme ? La châtellenie faisait-elle déjà partie du patrimoine provenant de son père, de sa mère ou l’a-t-il acquise ? Le chroniqueur DE HEMRICOURT Jacques donne quelques informations sur le chevalier LEXHY DE WAROUX Libert dans son « Miroir des Nobles de Hesbaie ».
Ses parents sont DE WAROUX Breton « Le Vieux » (dit BURTON DE LEXHY), né en 1138 et décédé en 1210, qui a épousé DE TRAZAGNIES Marie. Le chroniqueur DE HEMRICOURT Jacques donne quelques informations sur DE WAROUX Breton « Le Vieux » dans son « Miroir des Nobles de Hesbaie ». Breton de Dammartin, d’Awir, de Lexhy, dit « Le Vieux de Waroux », chevalier, sire et voué d’Awans, Seigneur de Waroux, de Geneffe, de Limont. Breton « Le Vieux », Seigneur de Waroux, second fils d’Hugues II d’Awir surnommé « de Lexhy », fut extrêmement riche et fort puissant en crédit. Il était seigneur de Waroux et voué d’Awans. Puisque le château et la vouerie d’Awans lui appartenaient, lui et ses successeurs prirent le nom de Seigneur d’Awans. Il fut aussi seigneur de Geneffe et de plusieurs autres villages. C’est de lui que sont issus les membres des familles d’Awans et de Waroux. Il épousa Marie de Trazegnies. Ils eurent sept garçons et deux filles. Leur fils aîné est Libert Lexhy de Waroux de Jeneffe.
Les parents de Breton le Vieux de Waroux sont Hugues II d’Awir de Lexhy (dit Hugues de Lexhy), né en 1114, qui a épousé Marie d’Agimont. Le chroniqueur Jacques de Hemricourt donne quelques informations sur Hugues II d’Awir « de Lexhy » dans son « Miroir des Nobles de Hesbaie ». Ayant pris l’ordre de chevalerie, Hugues II d’Awir « de Lexhy » se vit assigner pour héritage Lexhy, Limont, Geneffe, Waroux, la vouerie d’Awans et plusieurs autres biens d’une autre nature. Comme son frère, il prit possession des biens qui constitueraient son héritage et put en jouir pour entretenir son train de vie, dans l’attente du reste du patrimoine qu’il recevrait après la mort de son grand-père, Libert-Suréal de Warfusée, et de son père Raës « à la Barbe » de Dammartin. Il épousa Marie d’Agimont. Ils eurent quatre fils : Otto de Lexhy (branche de Lexhy), Breton « Le Vieux » de Waroux (branche de Waroux), Henri de Crisgnée (branche de Crisgnée) et Badout de Voroux.
Les parents d’Hugues II d’Awir de Lexhy sont le Comte Raes « à la Barbe » de Dammartin, un exilé français, né en 1090, qui s’est d’abord établi à Huy. En 1115, il y a épousé Alix de Warfusée, née en 1091, riche héritière des seigneuries de Hesbaye : Warfusée, Limont, Hollegnoul (aujourd’hui Hognoul), Villers-l’Evêque, Fouz (aujourd’hui Fooz), Bollezée (aujourd’hui Bolsée-lez-Ans), Geneffe (aujourd’hui Jeneffe), ainsi que les voueries d’Awans et de Waroux. La branche « paternelle » vient donc de France. Par contre, la branche « maternelle » est une bonne piste. Le chroniqueur Jacques de Hemricourt raconte l’histoire de Raës « à la Barbe » de Dammartin et et d’Alix de Warfusée dans son « Miroir des Nobles de Hesbaie ». Messire Raës à la Barbe, pour une raison inconnue, encourut la disgrâce du Roi de France Philippe. Obligé de quitter le toyaume, il sortit avec beaucoup d’argent, de pierreries et un grand équipage. Il vint s’installer près de Huy, avec sa suite et un train magnifique. Il y avait quantité de chasseurs, d’oiseaux et de fauconniers. La chasse et la pêche étaient ses divertissements favoris. Un jour qu’il chassait sur les terres de Warfusée, il entendit, à l’approche de midi, la clochette qui avertit de l’élévation. Il poussa aussitôt son cheval vers la chapelle du château, pour aller y entendre le reste de la messe. Il mit pied à terre et entra dans la chapelle. L’aumonier du seigneur de Warfusée officiait devant l’autel. Le seigneur des lieux était agenouillé sur un prie-dieu. Ayant entendu du bruit, le seigneur de Warfusée se retourna et aperçut ce chevalier inconnu. L’office terminé, il l’aborda et le pria de lui faire l’honneur de dîner avec lui, ce que Messire Raës accepta volontiers. Le seigneur de Warfusée le prit alors par la main, lui faisanr grand accueil. Il s’informa de son nom et de l’aventure qui l’avait conduit en ce lieu. Tout en devisant, il l’emmena dans la salle de son château et commanda que l’on mit le couvert. Il fit appeler sa fille adorée, Alix, pour entretenir cet illustre étranger et lui rendre les civilités qu’on doit en pareille rencontre. La demoiselle parut dans la salle et fit au chevalier uen révérence de la meilleure grâce du monde. Elle lui témoigna ensuite l’accueil le plus obligeant et s’approcha de lui d’un air honnête, sage et modeste, selon la bonne éducation que son père lui avait fait donner. Le bon seigneur de Warfusée les fit asseoir l’un à côté de l’autre. Messire Raës et sa suite furent si bien reçus qu’il en fut tout étonné. Après qu’ils eurent dîné et qu’ils se furent divertis de tout ce qui pouvait donner plaisir et joie, Messire Raës remercia le seigneur de Warfusée et sa charmante fille pour le bon accueil qu’ils lui avaient réservé. Il prit congé d’eux fort civilement. Le bon seigneur de Warfusée le pria avec insistance de revenir le voir aussi souvent que son chemin l’amènerait près du château, car il aimait la bonne compagnie et prenait grand plaisir à recevoir la visite de personnes de rang et de mérite. Le chevalier promit d’autant plus volontiers qu’il était tombé sous le charme de la fille du seigneur de Warfusée. Il ne manqua pas de s’acquitter de sa promesse et ne rata aucune occasion de venir visiter la jeune fille. Raës à la Barbe de Dammartin épousa la demoiselle Alix de Warfusée et fit construire une tour et un édifice de plusieurs logements, à proximité du domaine de Warfusée. La première année du mariage, ils eurent un fils qu’ils nommèrent comme son grand-père : Libert-Suréal. Deux ans plus tard, environ, ils eurent un autre fils qu’ils nommèrent comme son bisaïeul maternel : Hugues d’Awir, qui sera surnommé « de Lexhy ».
Ailide ou Alix de Warfusée est la fille unique de Libert-Suréal de Warfusée, né en 1053 et d’Agnès d’Awir. Le chroniqueur Jacques de Hemricourt raconte l’histoire de Libert-Suréal de Warfusée et d’Agnès d’Awir dans son « Miroir des Nobles de Hesbaie ». Il y avait aussi alors à Awir, près de Warfusée, un seigneur, nommé Hugues, marié à la sœur du comte de Hozémont, qui avait une fille nommée Agnès. Libert-Suréal la rechercha en mariage et l’obtint. Ils réunirent ensemble de très grands héritages. Ils s’aimèrent loyalement et furent tellement fortunés qu’ils acquirent encore pendant leur mariage les villages et seigneuries de Geneffe, de Limont, de Lexhy, d’Awans, de Waroux, de Loncin et plusieurs autres : en sorte qu’ils se virent possesseurs d’une bonne partie de la Hesbaye liégeoise. L’unique fruit de leur union fut une fille, nommée Alix. Quelques années après la naissance d’Alix, Agnès trépassa. Le bon seigneur de Warfusée en ressentit une sigrande tristesse qu’il en pensa mourir. Quand la violence de sa douleur fut un peu calmée par les instances de ses amis et par les caresses de sa fille, qu’il aimait outre mesure, et qui doucement le consolait, il jura qu’il ne porterait plus les armes ; qu’il se consacrerait désormais à Dieu, et qu’il prierait tout le reste de sa vie pour le repos de celle qu’il avait perdue. Il se fit prêtre et il célébrait souvent lui-même la messe dans son château fort de Warfusée, ou dans ses autres châteaux quand il s’y trouvait. Toutefois ce changement d’état ne lui fit rien diminuer du train de sa maison. C’était le rendez-vous de tous les chevaliers des environs, parce qu’on le reconnaissait pour chef de sa race. Il tenait une grande quantité de chiens et d’oiseaux. On s’étonnait de voir tout ce qu’il dépensait pour Dieu et distribuait en aumônes. Il faisait élever sa fille conformément à sa condition : de sages maîtresses lui enseignaient tout ce qu’une noble demoiselle doit savoir : à travailler en or et en soie, à dire ses heures, à lire de beaux romans de chevalerie, à s’amuser à toutes sortes de divertissements honnêtes, comme à jouer aux échecs et aux dames, … tellement qu’il eut été difficile de rencontrer ailleurs sa pareille. Et avec cela, elle était belle et avait bonne grâce à tout ce qu’elle faisait. Tant de qualités et de vertus la rendaient de plus en plus chère au bon seigneur de Warfusée. C’était sa consolation et toute sa joie.
En 1145, DE LEEZ II Henri est nommé prince-évêque de Liège. Il occupera cette fonction jusqu’en 1164.
En 1200, DE PIERREPONT Hugues est nommé Prince-Evêque de Liège. Il occupera cette fonction jusqu’en 1229.
Une châtellenie, avant la fin du 12ème siècle, c’est un ressort territorial commis à la garde d’un châtelain.