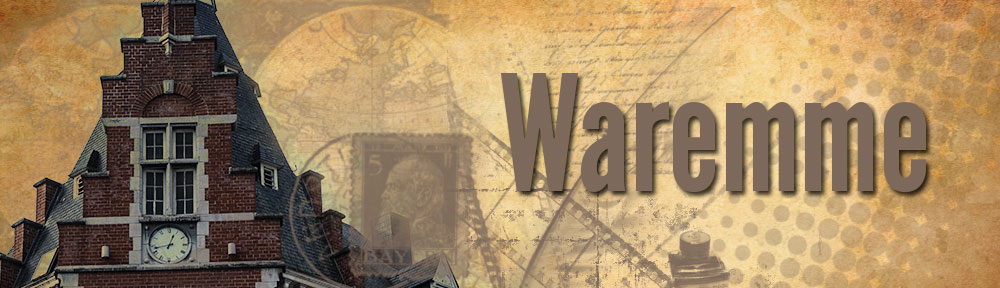Vers 1100, les paysans (vilains, manants, roturiers), qui cultivent les terres du seigneur ou du Chapitre, résidant en ville, ne sont que demi-libres. Outre le loyer ou cens (d’où viendra plus tard le mot « censier ») et la dîme, ils payent la taille (impôt sur les revenus qu’ils vont plus tard continuer à payer au mayeur). En plus, ils payent des taxes, entre autres : sur le sel (impôt appelé gabelle dans certaines régions), qui restera jusqu’au début du XXe siècle l’élément indispensable pour conserver les viandes, de porc, notamment ; sur la mouture du blé : les paysans sont obligés d’aller faire moudre leurs grains dans un moulin à eau appartenant au seigneur ou au chapitre, les moulins à vent sont encore peu connus. (l’idée du moulin à vent sera rapportée d’Orient par les Croisés). Enfin, les paysans doivent au seigneur des corvées pour l’entretien du château, de ses dépendances et du village : murs, haies, bois, routes, fossés, « flots », … Les masuriers sont encore plus mal lotis.
Paysans et masuriers vivent misérablement. Les moyens de transport n’existent pas. La plupart des petites gens naissent et meurent sans avoir vu d’autre horizon que celui de leur village ou du village voisin.
Les routes sont en terre battue et se transforment en bourbier à la moindre averse. Elles suivent les pentes du terrain et aux endroits bas du village s’accumulent dans des mares appelées « flots ». Ces mares, couvertes d’une pellicule verdâtre, sont génératrices de miasmes de toutes sortes, lesquels alimentés par le manque d’hygiène élémentaire engendrent de fréquentes épidémies qui déciment la population. A côté des maladies de l’enfance qui entraînent la mort d’un grand nombre d’enfants, il y a le choléra (miserere), le typhus (dû aux poux), la fièvre typhoïde provoquée par les conditions d’hygiène désastreuses, le charbon (maladie particulière aux régions d’élevage), … La lèpre et la peste, ainsi que la famine, semblent être des cas isolé en Hesbaye. Cet état de chose va se prolonger jusqu’au début du XXe siècle à peu près, jusqu’à l’apparition de la médecine moderne.
Paysans et masuriers habitent des maisons en terre dans lesquelles on descend par quelques marches. La plupart ne comportent que deux pièces : l’une servant de cuisine, l’autre de chambre.
Il n’y a pas de meuble, sinon un coffre qui sert de garde-robe et de table. Les habitants dorment par terre, sur des paillasses, grands-parents, parents et enfants, dans une promiscuité génératrice de maladies et de turpitudes. Il n’y a pas de chaises, mais des escabeaux. Il n’y a pas de poêle de chauffage : ceux qui ont les moyens disposent d’une cheminée à feu ouvert ; les autres cuisent sur un four fait de quatre pierres assemblées. Dans les masures, l’éclairage est nul, en dehors de la chandelle de suif qu’on n’allume qu’en cas de nécessité urgente.
On mange du pain noir, qu’on va faire cuire au four banal (en payant bien sûr). Il s’agit du pain de seigle et d’épeautre. L’épeautre est la céréale la plus cultivée parce qu’elle se contente d’une terre maigre et peu travaillée (le froment qui est la céréale des terres riches, bien engraissées et bien ameublies, n’apparaît semble-t-il qu’au XVIIIe siècle). Les plus pauvres, sur leur lopin de terre, préfèrent le seigle parce que sa paille servait à plusieurs usages : toit de la cabane, paillasse, liens, …
Le pain non bluté est frotté d’un peu de saindoux ou de graisse de lard (récoltée en faisant fondre un morceau de lard dans la cheminée) ou de maquée.
Comme repas chaud, la soupe à base de légumes et de lard (la pomme de terre était inconnue à cette époque).
On boit de l’eau, du petit-lait (le bon lait étant réservé aux malades) et de la cervoise (espèce de mauvaise bière). L’abus de cervoise était générateur de bagarres fréquentes.
Les gens du peuple portent des vêtements de bure. La plupart sont chaussés de sandales en écorce et parfois de sabots.
La médecine et la pharmacie sont inexistantes. Certaines personnes qui ont hérité du secret des plantes, prescrivent des tisanes additionnées de miel et parfois de sucre. Le sucre, importé d’Orient après les Croisades, est un produit rare, utilisé uniquement en pharmacie.
La pratique religieuse est obligatoire, et sans doute nécessaire pour soutenir l’homme à travers ses misères. Les nantis lui serinent à longueur de journée que plus il est malheureux ici-bas, plus il sera heureux dans l’au-delà.
La vie des « petites gens » n’a aucune valeur pour leur maître, sinon au travers du travail qu’elles peuvent accomplir pour lui assurer son bien-être. Ainsi, en temps de guerre, seuls les nobles sont soignés. Les soldats blessés sont laissés livrés à eux-mêmes ; parfois ils sont envoyés mourir derrière une haie où un préposé à cette sinistre besogne les acheve. Mais dès que l’homme est mort, il redevient la propriété de Dieu et devient sacré.
La justice est aux mains du seigneur. Jusqu’au début du 14ème siècle, il a droit de vie et de mort sur tous ses sujets. C’est l’époque des « duels judiciaires » et des « jugements de Dieu ». En cas de délit grave, les plaignants doivent parfois se battre à mort ; le vainqueur est désigné comme l’innocent. Ou, pour faire preuve de son innocence, l’accusé doit prendre en main une barre de fer rougie au feu ou mettre en bouche une cuiller d’huile bouillante. Mais sous l’influence des Métiers de Liège et aussi de l’Eglise, qui s’emploie à réfréner les ardeurs belliqueuses et criminelles des seigneurs, des cours de justice locales vont se constituer.
Cette justice, bien que plus modérée en raison de la présence d’échevins-jurés, est encore barbare dans son déroulement et ses sanctions. On y applique encore la « question » (torture) et la loi du Talion, qui consiste à punir le coupable par l’injure qu’il a faite : si au cours d’une rixe, il a crevé un œil à son adversaire, on lui crève également un œil. La peine de prison (oubliettes) n’existe plus. Pour les petits délits on applique le fouet ou la bastonnade ; pour les délits les plus graves la mort par la corde, le feu ou d’autres procédés plus « raffinés ». Chaque condamné doit, en plus, payer une amende en rapport avec son forfait et faire un pèlerinage d’amendement, parfois très loin (Rocamadour en France, Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, Rome en Italie, ou en Terre Sainte). Celui qui ne s’y soumet pas est rejeté, non seulement de l’Eglise, mais aussi de la communauté : il est alors déclaré « aubain », c’est-à-dire banni.
L’instruction n’existe pas. En dehors de gens d’Eglise, la plupart sont illettrés.
Les loisirs sont inconnus : hommes, femmes et enfants travaillent comme des bêtes de l’aube au crépuscule, passant leurs dimanches aux offices et à se reposer.
Mais parfois, les sujets du seigneur sont autorisés à assister aux tournois ou à l’une ou l’autre représentation que viennent donner des baladins (chanteurs, comédiens, saltimbanques, montreurs d’ours, …) qui vont de château en château pour distraire les châtelaines en train d’attendre le seigneur, la plupart du temps absent.