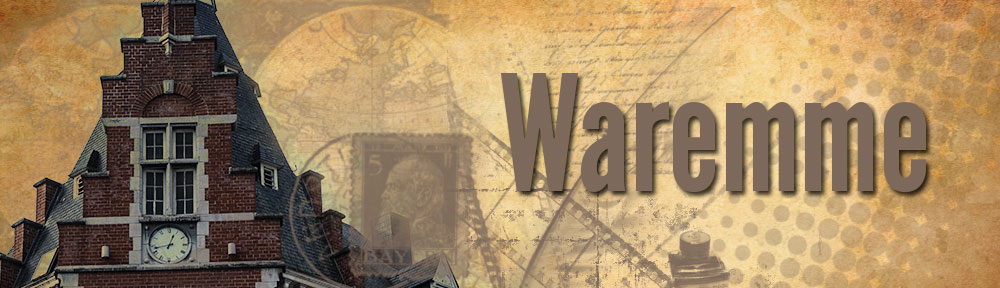Vers 1800, les fermes sont souvent de 70 à 100 hectares. Parfois 120 hectares. Les fermes « au carré » présentent un corps de logis et deux ailes composées de granges, d’étables et de remises. L’espace entre ces bâtiments est occupé par une cour qui, dans son milieu, présente une pente insensible vers le porche d’entrée. Le fumier peut s’y écouler. Le rez-de-chaussée de corps de logis comprend une grande cuisine avec une large cheminée et la chambre du fermier. Parfois un entresol, avec une vue sur le foyer et toute la cuisine, où logent les filles du fermier et les servantes. L’étage se compose de trois ou quatre chambres. Dans le grenier, on place les grains de la récolte. Les valets couchent dans les écuries. Les matériaux de construction utilisés sont : la brique (que l’on confectionne sur place), la pierre de taille pour les montants de porteet ceux des croisées, liées par du mortier fait avec de la chaux et du sable. On se sert de chaume pour les toits. Rarement de tuiles ou d’ardoises. Dans chaque ferme on trouve un puits plus ou moins profond.
Les petites maisons ne comportent que deux pièces au rez-de-chaussée et deux chambres à l’étage. Les parents logent dans une « alcove » de manière à pouvoir surveiller le feu pendant la nuit, les enfants dans la pièce voisine. Les lits à ressorts n’existent pas. On dort sur une paillasse de paille de seigle et l’oreiller est de balles d’avoine. Les maisons, même les plus humbles, sont pourvues de fenêtres vitrées.
Dans les villages, il y a plusieurs puits à usage commun.
Il n’y a guère de meubles (sauf chez les riches fermiers), en dehors du coffre, d’une grande armoire et, éventuellement d’une commode. L’emploi de la table s’est généralisé, mais les chaises sont encore rares : on s’assied sur des « hammes » (bancs). Les verres à boire remplacent les gobelets en métal, en terre ou en bois. Les articles en faïence : plats, assiettes et tasses, ainsi que les couverts en métal (étain ou fer blanc) apparaissent sur toutes les tables.
L’éclairage se fait au moyen du crasset ou lampe à huile (lamponnette) ou encore de lanternes vitrées avec une bougie.
Au niveau de l’alimentation, les grands propriétaires et les fermiers aisés se nourrissent assez bien : viandes fraîches et légumes, arrosés de bière forte et , de temps à autre, de vin. Les autres habitants se nourrissent de lard, de pommes de terre et de légumes ; ils boivent de la bière.
Il y a des débits de boissons dans chaque village et des auberges à Waremme.
Quant à l’habillement, les travailleurs portent des sarreaux bleus, plats et sans plis. Sous cette espèce de chemise qui descend jusqu’aux genoux, ils portent une veste d’étoffe de laine de couleur grise, quelquefois lignée, avec une culotte de toile, de velours de coton ou de la même étoffe que la veste, et des bas de laine de couleur grise ou noire. Ils portent des souliers forts. Les sabots ne sont portés qu’à l’intérieur des maisons, pour les travaux dans les écuries, le transport des engrais et le battage des grains. Des souliers plus fins et des bottes servent le dimanche et dans les voyages. Le chapeau rond est celui dont on fait le plus usage. Un mouchoir, blanc ou de couleur, sert de cravate. Le dimanche, tous les hommes, si l’on excepte les gens de peine qui sont toujours en sarreaux, portent un habit de drap bleu plus ou moins fin, un gilet de couleur et des bas de coton blanc ou mêlé de bleu céleste.
Les femmes portent ordinairement une capote et une jupe d’étoffe de laine. Elles ont une cornette de toile de coton et leurs cheveux, retroussés par derrière, forment un chignon très saillant. En tout temps, leur tête est enveloppée par un mouchoir de couleur plié diagonalement et noué sous le menton. Elles portent des bas de laine, et outre les sabots qui sont leurs chaussures ordinaires pour tous les travaux de la campagne, elles ont presque toutes, pour les jours de fête et les voyages, des souliers avec de grandes boucles d’argent qui couvrent tout l’avant-pied. Celles qui jouissent de quelque aisance portent des habillements de toile de coton, de perkale ou de soie ; des tabliers de mousseline garnis de dentelle, … Les plus riches s’habillent comme à Paris …
La cérémonie de baptême n’est pas coûteuse, même pour ceux qui aiment à se distinguer. En quittant l’officier de l’état-civil, on se rend à l’église. La sage-femme porte l’enfant, sur le bras droit si c’est un garçon, sur le bras gauche si c’est une fille. Les langes dont l’enfant est enveloppé appartiennent aux parents, L’étoffe recherchée qui recouvre ces langes appartient à la sage-femme, qui s’en sert pour tous les enfants qu’elle porte sur les fonts baptismaux. Plus les parents de l’enfant jouissent de considération ou d’aisance, plus l’enveloppe que procure la sage-femme est précieuse.
Les divertissements sont rares, en dehors du jeu de carte le dimanche au cabaret, des parties de quilles ou de décapitation de l’oie.
La Fête au village est la grande occasion de retrouvailles avec les parents et amis étrangers au village. Elle débute le dimanche par une grand-messe, suivie d’une procession dans les rues du village, à laquelle participe toute la population. Après cette procession, un dîner réunit dans chaque maison les gens de la famille et les invités. L’après-midi, les jeunes gens organisent des « longues danses » ou « crâmignons » à travers les rues. Le soir, un bal public est organisé, à proximité duquel se trouvent quelque fois des traiteurs forains, des marchands de gâteaux et de pains d’épices, des petits jeux de hasard, …
Les cultures pratiquées à cette époque sont l’épeautre, le froment, l’avoine, l’orge et le seigle. Le trèfle et un peu de luzerne sont la nourriture principale des chevaux. On cultive aussi la pomme de terre, le chanvre, le colza et les fèverolles. On pratique l’assolement triennal ou quadriennal. On utilise comme enfrais le fumier, la marne et les boues de ville (rarement d’engrais chimique).
Les instruments agricoles : araire, rouleau et herse, voient apparaître une nouvelle espèce de charrue : la charrue à tourne-oreille. Les semailles se font à la main, au moyen d’une espèce de grand linceul en toile dure qu’on suspend au cou et qu’on torsade autour du bras gauche. L’art du semeur consiste à emplir la main et à laisser filer les grains suivant un débit régulier entre le pouce et l’index.
La moisson se fait à la faux ou à la pique flamande. On rentre les blés avec des chariots ou charrettes en bois de chêne ou de frène, aux grandes roues cerclées de fer et dont le timon est fait de bois de charme.
Le battage s’effectue au fléau, par groupe de deux hommes frappant en cadence. La séparation du grain et des balles se fait avec le van : un panier en osier d’environ 50 centimètres de diamètre, muni de deux anses latérales. Cette tâche est extrêmement fatigante et peu salubre, à cause de la poussière et des courants d’air. Elle consistait, le jour où il y a du vent, à lancer en l’air quelques kilos de blé et à les rattraper, le vent se chargeant de nettoyer le blé en soufflant la paille de côté.
Quant à la mouture, elle se fait au moulin (à eau ou à vent).
La fermière continue à s’occuper du lait. Il est entreposé au frais pendant 24 heures dans des terrines. Chaque jour elle recueille au moyen d’une spatule ou avec le revers de la main, la crème, plus légère, qui s’est déposée en surface. Le battage se fait au moyen d’une baratte à main, sorte de cylindre en bois, dans lequel le battoir se meut comme un piston de haut en bas.
Un progrès apparaît dans le lessivage, le savon et la planche à lessiver.